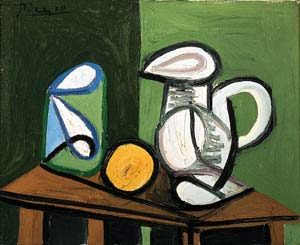Sur la table, quelqu'un avait déposé un vase,
une cruche et une orange. L'orange avait roulé au pied
de la cruche ; le vase semblait vide et avait détourné
son attention hors de la table, tandis que la cruche attendait, comme
une cruche, qu'il veuille bien jouer son tour.
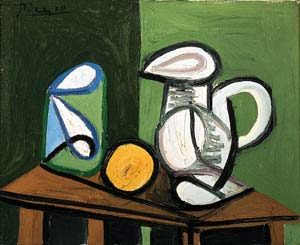 |
| Picasso, Nature morte
au pot et à l'orange |
C'est ainsi, sur le mode narratif, que ce tableau s'offre
à l'observation. Tout tend à dramatiser le rapport
(ou faut-il dire « les relations » ?) entre ces objets
du quotidien, à commencer par la composition du lieu de cette
rencontre, véritable dispositif de théâtre. La
scène se passe sur une table, contre un mur ; mais ce mur,
bicolore, divise la toile en deux rectangles symétriques -la
partie gauche, celle du vase, est en vert sombre, et la partie droite,
celle de la cruche, en vert clair. On pourrait d'abord croire
qu'il s'agit d'un coin de la pièce, donc
de deux murs qui se rejoignent, l'un recevant plus de lumière
que l'autre. Mais aucune indication de perspective ne vient
confirmer cette hypothèse rationnelle ; la table est représentée
sous différentes perspectives (elle est vue à la fois
depuis le côté droit et le côté gauche)
mais ne laisse en tout cas pas voir l'angle supérieur,
qui serait convenablement logé dans le coin du mur. Il semble
donc qu'ici, un même pan de mur ait été
peint de deux verts différents, ce qui nous rend curieusement
attentifs à la peinture de ce mur, qui n'est plus une
simple toile de fond, mais bien le principe coloré qui organise
le tableau - ces deux verts semblent faits pour accueillir la
disposition inversée de la nature morte, le vase couleur vert-clair
posé du côté vert-foncé du mur, tandis
que la cruche cernée d'un vert-foncé presque noir
se trouve du côté vert-clair. Ce sont donc les objets
qui imposent leur logique colorée à l'organisation
de l'espace alentour. On note aussi que l'orange est placée
exactement entre les deux pièces de vaisselle belligérantes,
exactement sur la ligne de jonction entre les deux pans de mur vert
- l'orange est comme une balle placée sur la ligne de
démarcation d'un terrain de jeu. La balle est au centre.
Autour de l'orange, c' « est un cas entre autres
de mise en présence, comme s'il s'agissait
d'illustrer ou de théâtraliser -en un apologue
qui aurait pour acteurs ces êtres rassemblés -
l'œuvre mystérieux qu'opère, ou devrait
opérer, tout art figuratif : mettre en présence d'une
réalité, au demeurant quelconque, et que cette présence,
en tant que telle, soit intensément éprouvée »
(Michel Leiris, Un génie sans piédestal). Autour
de l'orange, ce fruit qu'on nomme par sa couleur, et qui
ici est la seule couleur qui réellement détonne,
est initié l'échange entre la cruche et le vase,
par jeu de formes et conversation de couleurs. Le « jeu »
ici se conçoit de plusieurs manières et il est d'abord,
à la manière du jeu théâtral, du jeu d'enfant
ou du rituel, un principe de métamorphose - en l'occurrence
la transformation de choses inanimées en êtres «
intensément » vivants : le trouble le plus manifeste
porte sur la cruche blanche et ronde, qui évoque sans hésiter
la forme et l'attitude d'un oiseau qui s'est posé,
le bord de la cruche allongé comme un bec (et ce cerne rose
qui, à l'intérieur du bord noir, évoque
un œil), l'anse faisant figure d'aile repliée
(prolongée dans le corps de la cruche par la ligne noire qui
le traverse, et souligne ce mouvement replié), et les pattes-pied
de la cruche repliées sous sa panse. La forme en goutte qui
fait la tête de l'animal se retrouve sur le vase, qui
ainsi a peut-être l'air de regarder ailleurs. C'est
une peinture animiste des objets : sur la traditionnelle table de
la nature morte devenue table de jeu, chaque chose prend vie, et cette
dimension ludique nous est sans cesse rappelée à travers
l'œuvre de Picasso qui, s'il ne transforme pas comme
ici l'apparence des objets en les peignant, les utilise à
l'intérieur d'un dispositif qui les détourne
- jeu d'objets qu'on dépayse, comme la petite
automobile de son fils Claude transformée en mâchoire
de guenon. Car Picasso « paraît mal supporter que les
choses, laissées à leur inertie, demeurent ce qu'elles
sont ; et il applique toutes les ressources de son génie, à
les changer en autre chose, soit fictivement, par l'espèce
de transmutation que l'art fait subir à ce qu'il
a pris pour modèle, soit réellement, par un usage qui,
tout en respectant la forme de ces matériaux ramassés
presque au hasard les dotera d'une autre signification »
(Michel Leiris, Un génie sans piédestal) ;
ce qu'on retrouve dans les trois vases de la Nature
morte aux cerises également exposée à
Filiations : trois vases au corps dessiné se regroupent
sur la table, et on dirait trois bonnes sœurs (le bord formant
tête et le contour dessinant un voile) en plein bavardage passionné.
 |
| Picasso, Nature morte
aux cerises |
1/2 - page suivante